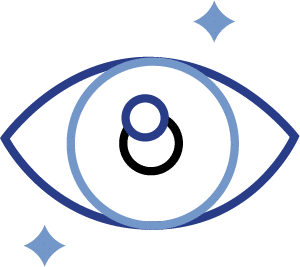Prise en charge du kératocône
Les solutions pour améliorer la vision et stabiliser la maladie
La prise en charge du kératocône repose sur une progression thérapeutique par étapes. Le but est d’améliorer l’acuité visuelle, de ralentir l’évolution de la maladie et de préserver le confort quotidien. Les solutions proposées varient selon le stade de la
maladie, la gêne fonctionnelle et la tolérance du patient aux différentes options.
Correction optique : lunettes et lentilles
Les lunettes
Les lunettes peuvent corriger la vision dans les formes très précoces du kératocône. Toutefois, leur efficacité devient rapidement limitée en raison des irrégularités de la cornée, que les verres correcteurs standards ne peuvent compenser.
Les lentilles de contact
Dès que les lunettes ne suffisent plus, on a recours à la contactologie spécialisée. Les lentilles permettent de recréer une surface optique régulière. Cet équipement nécessite une consultation avec un/e contactologue spécialisée. Le Dr DAVID pourra vous conseiller le praticien.
Parmi les solutions possibles :
- Lentilles rigides perméables aux gaz (LRPG) : standard de la correction du kératocône, elles s’adaptent à la forme irrégulière de la cornée et offrent une excellente qualité visuelle.
- Montages “piggy-back” : une lentille souple est portée sous la lentille rigide pour améliorer le confort.
- Lentilles hybrides : centre rigide pour la vision, collerette souple pour le confort.
- Lentilles sclérales ou cornéo-sclérales : reposent sur la sclère et non la cornée, utiles en cas d’intolérance aux lentilles classiques.
Les anneaux intracornéens
Les anneaux intracornéens sont de petits segments implantés dans l’épaisseur de la cornée. Ils sont proposés lorsque les lentilles ne suffisent plus ou deviennent mal tolérées.
Leur objectif :
- Re-modéliser la cornée en aplatissant sa partie centrale,
- Améliorer la régularité de la surface,
- Recentrer le cône,
- Améliorer la tolérance aux lentilles,
- Réduire les aberrations optiques et améliorer l’acuité visuelle.
Cette chirurgie mini-invasive est réversible et permet souvent un retour au port de lentilles, voire une autonomie visuelle partielle.
Les implants intraoculaires
Les implants intraoculaires peuvent être envisagés dans certains cas bien spécifiques, notamment lorsque la cornée est stable mais que subsiste une myopie importante ou une cataracte.
Implant phaque
Il est inséré entre l’iris et le cristallin, sans retirer ce dernier. Cette technique est rarement indiquée dans le kératocône en raison des exigences strictes anatomiques, rarement réunies chez ces patients.
Implant pseudophaque
Recommandé lorsque la cataracte est associée au kératocône. Deux options existent :
- Implant torique : utilisé lorsque le kératocône est stable, peu évolué, avec une cornée régulière.
- Implant sphérique : recommandé dans les formes avancées (>52 dioptries), lorsque la régularité cornéenne ne permet pas un calcul précis d’implant torique.
Une cible myopique est souvent choisie pour optimiser les résultats visuels, en fonction de la courbure cornéenne.
L’utilisation d’implants multifocaux reste très prudente, réservée aux yeux indemnes d’autres pathologies oculaires.
La greffe de cornée
La greffe de cornée est envisagée en dernier recours, lorsque toutes les autres options ont échoué ou que la cornée présente une opacité sévère gênant la vision.
Types de greffes :
- Kératoplastie transfixiante (KT) : greffe complète de la cornée. Longtemps standard, elle est aujourd’hui moins utilisée
- Kératoplastie lamellaire antérieure profonde (KLAP) : greffe partielle, conservant l’endothélium du patient. Elle présente :
- une meilleure résistance mécanique
- une meilleure tolérance immunologique
- une récupération plus rapide
- et une longévité accrue du greffon
Les complications les plus fréquentes après greffe (infection ou rejet) nécessitent une prise en charge rapide en cas de rougeur, douleur ou baisse de vision.

En résumé
Le traitement du kératocône est personnalisé et évolutif.
Les lentilles spécialisées sont souvent la première étape.
Des options chirurgicales existent : anneaux, implants, greffes.
Le choix dépend du stade de la maladie, de la tolérance aux lentilles, et de la qualité de vision résiduelle.
Un suivi ophtalmologique régulier est indispensable pour adapter la stratégie au fil du temps.